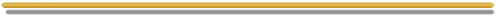NOTRE-DAME DE GUADALUPE et son image merveilleuse devant l'histoire et la science.
La Vierge au Mexique
NOTRE-DAME DE GUADALUPE
ET SON IMAGE MERVEILLEUSE
DEVANT L’HISTOIRE ET LA SCIENCE
par frère Bruno Bonnet-Eymard,
membre actif du Centro de Estudios Guadalupanos
 C‘est le voyage du Pape [Jean-Paul II] au Mexique, en 1979, qui la fit paraître sur nos écrans pour la première fois. L’Image, brouillée par la distance, était médiocre et nul commentateur ne se soucia de nous en conter l’histoire. Sa beauté, son énigme constituaient un appel. Ainsi naquit le projet d’un pèlerinage jusqu’au pied de cette Image attirante, mystérieuse, mais aussi d’une enquête soigneuse, historique et polytechnique, enquête dont la méthode nous parut très tôt devoir être rigoureusement semblable à celle que, après et avec bien d’autres, nous avons menée sur le Saint Suaire de Turin pour aboutir enfin à une déclaration d’authenticité absolue.
C‘est le voyage du Pape [Jean-Paul II] au Mexique, en 1979, qui la fit paraître sur nos écrans pour la première fois. L’Image, brouillée par la distance, était médiocre et nul commentateur ne se soucia de nous en conter l’histoire. Sa beauté, son énigme constituaient un appel. Ainsi naquit le projet d’un pèlerinage jusqu’au pied de cette Image attirante, mystérieuse, mais aussi d’une enquête soigneuse, historique et polytechnique, enquête dont la méthode nous parut très tôt devoir être rigoureusement semblable à celle que, après et avec bien d’autres, nous avons menée sur le Saint Suaire de Turin pour aboutir enfin à une déclaration d’authenticité absolue.
En effet, on ne peut pas apprendre son histoire sans désirer aussitôt la connaître, la voir, la vénérer. En 1531, dix ans après la conquête du Mexique par Cortés, un Indien chrétien du nom de Juan Diego, voit par trois fois la Vierge Marie lui apparaître pour lui demander de prier l’évêque élu de Mexico, Juan de Zumárraga, de lui construire une chapelle en ce lieu. Ce dernier demande un signe et la Vierge répond en imprimant miraculeusement, après une quatrième apparition, son propre portrait en pied sur la tilma de l’Indien. Depuis quatre cent cinquante ans cette Image d’une infinie délicatesse, empreinte sur un grossier textile de maguey, ne cesse d’attirer d’immenses pèlerinages. Tout Mexicain la tient pour miraculeuse.
À notre demande, des amis mexicains nous fournirent une première documentation, et j’organisai mon pèlerinage. Mais entre-temps, je reçus le livre de Jacques Lafaye : « Quetzalcóatl et Guadalupe. La formation de la conscience nationale au Mexique » (Gallimard, 1974). Préfacé par Octavio Paz, il contient la substance d’une thèse soutenue en Sorbonne par un disciple de Marcel Bataillon, thèse qui passe pour épuiser la question. Appuyée sur quarante-six pages de bibliographie, l’étude paraît exhaustive. Or, elle ne laisse rien subsister d’un « mythe » absolument dénué de fondement. Toute cette histoire d’« Image prodigieuse »serait née d’un syncrétisme pagano-chrétien, qui demeura latent au long des siècles de la colonisation espagnole et marqua l’éveil d’une conscience nationale, à partir du XVIIesiècle, pour enfin aboutir à la libération du Mexique en 1813.
Le livre, pourtant, laisse paraître plusieurs contradictions, des lacunes notoires, et le parti pris agnostique de l’auteur est trop évident. Pour en avoir le cœur net, il fallait y aller voir. Je partis afin d’être là-bas pour les fêtes anniversaires de l’apparition (1981). La date choisie fut providentielle. Je rencontrai à Mexico d’éminents spécialistes internationaux. Je fus invité au Congrès que tient, chaque année à cette époque, depuis quatre ans, le Centro de Estudios Guadalupanos. Le thème de cette rencontre était justement « Los Antiaparicionistas », les antiapparitionnistes et la valeur historico-critique de leurs arguments. Ce furent trois journées de travail intense marquées par des communications de grande valeur, sous la présidence de S. Ém. le cardinal Ernesto Corripio Ahumada, archevêque-primat de Mexico.
Entre nos séances de travail et mes nombreuses démarches personnelles, j’allais prier à la Villa de Guadalupe,au milieu des foules de pèlerins venus du fond des campagnes indiennes souvent à pied ou à vélo, pour se prosterner devant l’Image de leur « Petite Mère », après s’être traînés à deux genoux sur l’esplanade pour lui demander pardon de leurs péchés.
Le charme irrésistible de l’Image, vers laquelle toute l’architecture ultra-moderne de la Nueva Basílica dirige les regards, acheva ce que les arguments des érudits guadalupanos avaient commencé. Ma conviction mûrement pesée, méditée, contrôlée par de longues heures d’enquête auprès des savants qui ont consacré leur vie à cette recherche, est que l’Image empreinte sur la tilma de Juan Diego est chose céleste. Il n’y a pas d’autre explication aux données mêmes de l’énigme posée par ce document unique dans toute l’iconographie chrétienne.
Ma démonstration reposera sur la critique externe, enquête historique, recherche des témoignages et de leur authenticité, et la critique interne, étude scientifique du textile, support de l’Image, ainsi que des propriétés étonnantes de l’Image elle-même. Je ne demande qu’une seule chose à mon lecteur. Qu’il se défasse de tout préjugé, et je suis sûr que son cœur s’enflammera d’amour pour la « Guadalupana » que tout Mexicain vénère et dont le message depuis 1531 n’a jamais manqué d’actualité, message dont nous voulons toujours nous faire les humbles serviteurs.
I. Un dialogue d’amour

« Juantzin, Juan Diegotzin ! »
Au lieu de l’effrayer, l’appel très suave, très doux, enflamme d’amour le cœur du macehualli, du campesino. La voix féminine, très caressante, appelle vers le sommet de la colline du Tepeyac, dans la direction du levant. Depuis un moment, Juan Diego fixe l’endroit des yeux parce qu’un ramage insolite s’y fait entendre, comme un concert d’oiseaux rares dont le chant harmonieux surpasse celui du cascabel, de la litorne marine et autres espèces au chant renommé qui peuplent les bosquets du Mexique. Soudain la musique s’est tue, le calme est revenu et une voix enchanteresse l’a appelé tendrement : « Mon petit Jean, mon petit Jean-Jacques ! » Mais ni la traduction française ni la traduction espagnole : « ¡ Juanito, Juan Dieguito ! » ne sauraient rendre exactement la nuance d’exquise courtoisie, de quasi révérence qui relève la familiarité contenue dans le suffixe nahuatl « tzin ».
Cuauhtlatóatzin–diminutif de Cuauhtla-tóhuac, « celui qui parle comme l’aigle » – a été baptisé sous le nom de Juan Diego en 1524. À cinquante-sept ans, c’est un homme encore alerte. Depuis qu’il a perdu sa femme, sa bien-aimée Lucía, il n’a plus de pensée que pour le Ciel. Aussi, en entendant cette musique merveilleuse, il se croit en paradis. Il racontera plus tard le tumulte de ses pensées, qu’un délicieux récit indigène, en langue nahuatl, a conservé fidèlement : « Est-ce que je le mérite ? Suis-je digne d’entendre une telle merveille ? Peut-être suis-je tout simplement en train de rêver ? Où suis-je ? Peut-être dans la Terre Fleurie dont nous parlaient les anciens, nos grands-parents, la Terre nourricière ? Peut-être suis-je au Ciel ? »
Voilà bien, pris sur le vif, le syncrétisme dont demeure imprégnée la mentalité de ces néophytes, dix ans après la Conquête, au témoignage même de toutes les chroniques missionnaires. D’emblée, c’est une note d’authenticité qui va s’affirmer de mille autres manières au long du récit. (…) Nous suivrons ici, en la paraphrasant librement, la version qu’a publiée la revue savante du Centro de Estudios Guadalupanos. (…) Cette traduction espagnole rend d’une manière particulièrement heureuse la fraîcheur colorée et l’inimitable familiarité, mêlée de révérence religieuse et d’exquise courtoisie, de ce premier dialogue que le Ciel engage avec la terre au seuil de nos temps modernes… en langue aztèque !
LA DAME ENTRE LES ROCHERS
Juan Diego, le cœur battant d’allégresse, grimpa là où on l’appelait et découvrit une ravissante jeune fille, éblouissante de lumière, qui se tenait debout et lui demandait d’approcher. Quand il fut tout près, c’est elle qui engagea le dialogue d’amour :
« Écoute, mon petit enfant, le plus petit, où vas-tu ? »
Lui était saisi d’admiration devant cette beauté qui n’était pas de la terre. Son vêtement était comme le soleil ; il irradiait des rayons de lumière qui transfiguraient tout. Les rochers et les cailloux de ce mont aride, entre lesquels poussaient quelques acacias et cactus, étaient métamorphosés en pierres précieuses, fines émeraudes et turquoises. Et la terre était baignée par des vagues d’arcs-en-ciel.
« Ma Dame, mon enfant, ma Reine,répondit le vieil homme prosterné devant la toute jeune et noble enfant, je m’en vais aux affaires de Dieu, celles que nous enseignent les ministres de Notre-Seigneur, nos prêtres. »
Ce matin-là, samedi 9 décembre 1531, premier jour de l’octave de l’Immaculée-Conception, Juan Diego se rend à la messe à Tlatelolco où les franciscains, premiers missionnaires de la Nouvelle Espagne, ont établi une sorte de centre catéchétique. Ils distribuent les sacrements et dispensent l’instruction chrétienne à tout un peuple de néophytes qu’ils arrachent laborieusement au paganisme ancestral.
MÈRE DU VRAI DIEU
Alors, lui montrant beaucoup d’amour, elle reprit :
« Sache et tiens pour certain, mon fils, le plus petit, que je suis la parfaite et toujours Vierge Marie, Mère du vrai Dieu, de Celui par qui tout vit, le créateur des hommes, le Maître du voisinage immédiat et le Seigneur du ciel et de la terre. »
Ces noms divins pleins de mystère, intraduisibles, désignaient, parmi les divinités du panthéon aztèque, un « dieu inconnu, créateur de toutes choses »,auquel le pieux roi de Texcoco avait érigé au siècle précédent, selon le chroniqueur Ixtlilxochitl son descendant, un temple en forme de haute tour sans aucune statue ni idole. (…) C’est donc ce Dieu-là qui est « le vrai »,dont la Vierge Marie se déclare la Mère. Elle poursuit :
« Je désire très ardemment, et c’est ma volonté, qu’en cet endroit on me construise mon petit teocalli. »
Le mot est formé de teotl,dieu, et calli,maison : « maison de dieu ».Il désigne les sanctuaires que les Mexicains élevaient jadis à leurs dieux au sommet de vertigineuses pyramides, où les prêtres immolaient les victimes humaines sur la pierre du sacrifice, au temps de la religion des « grands-parents »de Juan Diego.
Or, voici qu’au sommet de la petite colline pyramidale du Tepeyac qui borde au nord la lagune de Mexico, la Vierge Marie demande modestement qu’on lui construise pour elle un petit teocalli : noteocaltzin,« un petit teocalli pour moi ».Mais ce n’est pas pour s’y faire adorer, à l’instar d’une nouvelle divinité ; c’est bien plutôt pour y établir le culte du « vrai Dieu », son Fils :
« … là, je Le montrerai, je L’exalterai, je Le donnerai aux hommes, par la médiation de mon amour à moi, de mon regard compatissant, de mon aide secourable, de mon salut. »
Ici, (…) remarquons la profondeur des paroles de la Très Sainte Vierge, qui renversent en un instant non seulement les idoles cruelles de la religion païenne ancestrale, toujours vivace dix ans seulement après la Conquête, mais qui semblent d’avance prémunir les chrétientés naissantes amérindiennes, du protestantisme qui va bientôt passer l’Océan et s’implanter si vigoureusement dans la grande Amérique du Nord, voisine. En quelques mots, elle révèle ici son rôle de Médiatrice universelle. Non, elle ne demande pas qu’on lui construise une chapelle pour y être elle-même l’objet d’un culte d’adoration qui fut toujours étranger au catholicisme. Elle veut seulement être en ce temple la médiatrice d’une épiphanie du vrai Dieu, son Fils, afin de le manifester, de le glorifier, de le donner « aux hommes »,par la puissante vertu d’un simple regard de compassion jeté sur eux, qui leur procurera la grâce et les conduira au salut ; grâce et salut dont elle dispose en souveraine, qui sont siens véritablement puisque son Fils a tout remis entre ses mains.
MÈRE DE MISÉRICORDE
« … Je suis votre Mère miséricordieuse, la tienne et celle de vous tous qui vivez unis sur cette terre, et la mère de tous ceux qui, pleins d’amour pour moi, crieront vers moi et mettront leur confiance en moi. C’est là que j’écouterai leurs gémissements, leur tristesse, pour consoler, pour alléger toutes leurs peines, leurs misères, leurs souffrances.
« Pour que cela puisse se faire et que s’exerce ma miséricorde, va trouver l’évêque de Mexico en son palais et dis-lui comment je t’ai mandé, toi, mon messager, afin de lui représenter combien je désire avec beaucoup d’insistance que l’on me construise mon teocalli ici même. Tu lui raconteras bien tout ce que tu as vu et admiré, et tu lui répéteras fidèlement ce que tu as entendu.
« Et sois sûr que je me montrerai très reconnaissante et que je te rendrai heureux, que cette mission dont je te charge aujourd’hui sera récompensée ainsi que la fatigue et la peine que tu auras prises pour la mener à bien.
« Voilà, mon fils le plus petit. Tu as entendu ce que je t’ai dit. Va maintenant et fais tout ce qui est de toi. »
Relue quatre cent cinquante ans après, chacune de ces paroles consonne avec un contexte historique précis : celui des débuts difficiles de la Conquête, sans que le moindre anachronisme permette de détecter le faux postérieur. Par exemple, le siège de Mexico fut élevé au rang d’archevêché en 1547, et à partir de cette date le titulaire est toujours désigné par son titre d’archevêque. Mais le mot employé ici est bien obispo,conformément au titre primitif, contemporain des événements.
Il y a plus. C’est la controverse sur l’âme des indigènes.Dans la mentalité profondément chrétienne qui était encore celle de l’Europe au XVIe siècle, « le destin surnaturel de l’humanité étant une tunique indéchirable, du sort des Indiens dépendait celui de la chrétienté, et le sort des Indiens lui-même devait être écrit de toute éternité ; le problème revenait donc à identifier les habitants du Nouveau Monde avec la descendance d’un des patriarches de la Bible, de les rattacher en quelque façon à la lignée d’Adam (ou au contraire de les en exclure, ce qui fut également envisagé).» La solution va d’abord prévaloir selon laquelle « … il pouvait paraître aussi économique et rassurant de les retrancher de l’humanité et de les identifier à ces monstres dont les légendes antiques étaient remplies et qu’on n’avait jamais eu jusqu’alors l’occasion de rencontrer. C’est ce qui apparaît graphiquement sur certaines gravures de la fin du XVesiècle et même de plus tardives. Une telle position présentait le danger de rendre vaine toute tentative d’évangélisation, comme le comprirent bientôt les missionnaires, pêcheurs d’âmes qui se firent les champions de “ l’humanité ” des Indiens. En revanche, les conquérants y voyaient l’avantage de pouvoir exploiter sans merci les habitants du Nouveau Monde. Le problème de la nature des Indiens fut un des terrains de l’affrontement qui allait opposer durant la première génération surtout, les religieux aux colons. »(Lafaye, 61-62)
Intervenant dans ce grave différend, le pape Paul III prononcera que les Indiens sont doués de raison et donc destinés eux aussi à devenir fils de Dieu par le baptême. Mais le bref Cardinali toletano et la bulle Sublimis Deus ne datent que de 1537. Bien avant lui, la reine Isabelle la Catholique avait protesté, dès la fin du XVe siècle, que les Indiens étaient ses vassaux, au même titre que les Espagnols ; et qu’il était donc inique de les réduire en esclavage. Elle fit libérer ceux qui avaient été ramenés en Espagne, et parmi eux un esclave qui appartenait au père de Bartolomé de las Casas. « L’humanité des Indiens,poursuit Lafaye, si elle fut mise en doute par certains esprits, ne paraît donc avoir été à aucun moment problématique aux yeux des souverains. » (62)Mais Charles-Quint ne promulguera qu’en 1542 les « Nouvelles Lois des Indes » qui feront des Indiens de libres sujets de la Couronne.
Entre-temps, la race indigène aurait péri en Nouvelle Espagne, comme il arrivera en Nouvelle Angleterre au siècle suivant, où l’on peut parler de génocidethéorique et pratique ! si quelque chose n’était arrivé, un événement mystérieux sans lequel il est impossible d’expliquer comment il se fait qu’au sud d’une ligne est-ouest, Matamoros-San Diego, où l’Amérique devient latine, les Indiens ont survécu, non pas parqués en quelques réserves paléontologiques, mais en hommes libres, et ont mêlé leur sang à celui de leurs conquérants à tel point qu’il est devenu impossible aujourd’hui de définir les critères de l’indianité.C’est ainsi que l’ethnologie elle-même inclinerait à admettre la vraisemblance de cette intervention de la Vierge Marie, en 1531, au Mexique, dix ans après la Conquête, pour trancher le différend, de la plus simple et de la plus extraordinaire manière : c’est un Indien qu’elle choisit pour confident, et de la dernière catégorie sociale, un macehualli, « et más pequeño », le plus petit. Elle lui déclare qu’elle est sa Mère, pleine de miséricorde pour lui, Juan Diego, ainsi que pour ses pareils. Ce qui ne serait encore rien si elle n’était vraie Reine, puissante pour faire respecter sa volonté.
LA VIERGE ET L’ÉVÊQUE
L’Indien s’inclina profondément et dit :
« Ma Dame, ma Reine, je pars accomplir ce que tu m’as ordonné. À présent, je te quitte, moi, ton pauvre serviteur. »
Il s’en fut tout droit au palais de l’évêque. Les domestiques ne voulurent pas introduire ce misérable auprès de l’évêque. Mais il attendit avec la patience obstinée des humbles et fut enfin introduit. Il dit en son langage ce qu’il avait vu et entendu, et Juan Gonzalez, l’interprète érudit arrivé avec Cortés en 1519, traduisit ce récit à l’évêque-élu nouvellement arrivé, Juan deZumárraga, des frères mineurs. Celui-ci répondit : « Mon fils, il faudra revenir une autre fois. Je réfléchirai à tout cela. »
Le soir même, le voyant était de retour au sommet de la petite colline. La Reine du Ciel s’y trouvait, au même endroit que le matin. Elle l’attendait. Dès qu’il l’aperçut, il se prosterna devant elle jusqu’à terre et lui dit :
« Ma Maîtresse, ma Dame, ma Reine, ma toute petite fille, je suis allé là où tu m’as envoyé ; j’ai dit tes paroles et ton désir. Avec beaucoup de difficulté, j’ai fini par être introduit chez ce Monseigneur qui dirige tous les prêtres. Il m’a reçu de bon cœur et m’a écouté aimablement, mais j’ai compris dans sa façon de me répondre qu’il pense que cette idée de construire une église(teocaltzin) vient de moi et non de toi.
« Alors, je t’en supplie ma Dame, ma Reine, ma petite enfant, charge plutôt quelque noble ou personne en vue et estimée de transmettre ton désir et tes paroles si tu veux être crue. Parce qu’enfin, je ne suis qu’un pauvre homme, un portefaix, le plus rustre, le dernier du village. Je ne suis pas à ma place là où tu m’envoies. Oh ! ma petite demoiselle, toute petite fille, ma Reine. Pardonne-moi, je vais t’attrister, te faire du chagrin, tomber en ta disgrâce, et tu vas être irritée à cause de moi, ma Dame, ma Maîtresse. »
L’AMBASSADEUR « LE PLUS PETIT »
À ce langage, bien typé, la visiteuse céleste répondit :
« Écoute bien, s’il te plaît, mon tout petit enfant. Ils sont nombreux mes serviteurs, tous ceux que je pourrais charger de mon message et qui pourraient exécuter ma volonté. Mais il est absolument nécessaire que ce soit toi précisément qui l’exécutes, qui parles, et que mon désir et ma volonté se réalisent par ton entremise. Aussi je te prie, mon fils, toi le plus petit, et je t’ordonne de retourner demain matin chez l’évêque. Et redis-lui bien que c’est la Vierge Marie, Mère de Dieu, qui t’envoie. »
Juan Diego promit, tout en persistant dans son objection :
« Ma Dame, ma Reine, ma petite fille, je ne veux pas assombrir ton visage, ni faire de la peine à ton cœur : j’irai donc et de bonne grâce. Peut-être qu’il ne voudra pas m’écouter, ou s’il m’écoute, me croira-t-il ?
« Et demain, au coucher du soleil, je viendrai te donner la réponse de l’évêque. Maintenant je te quitte, ma fille, la plus petite, ma Vierge, ma Dame et ma Reine. Sois en paix (sic !). »
Le lendemain dimanche, après la messe, il s’en fut derechef se jeter tout en larmes aux pieds de l’évêque, lui répétant les paroles de la Reine du Ciel qu’il devait croire, et croire aussi sa volonté qu’on lui bâtisse une église là où elle le demandait.
Cette fois, Monseigneur lui fit mille questions : Comment était cette Dame ? où l’avait-il vue ? Le récit original ne nous rapporte pas la réponse de Juan Diego, mais dit seulement : « Il raconta tout à l’évêque, tout ce qu’il avait vu et admiré, et il en fit la description, montrant quelle était bien la Vierge, la Mère admirable du Sauveur, Notre-Seigneur Jésus-Christ. » Il dut raconter ce qu’il avait vu dans les termes mêmes dont nous nous servirions pour décrire l’Image que nous contemplons aujourd’hui : elle avait un beau visage de jeune fille d’une merveilleuse beauté, un peu brun, éclaire par un délicieux sourire maternel. Elle avait les mains jointes et la tête inclinée à droite, couverte d’un voile où fourmillaient des étoiles d’or et qui tombait jusqu’aux pieds. Elle a la taille d’une enfant de quinze ans et se dresse sur un croissant de lune tout noir sur lequel elle pose le pied droit, chaussé de gris cendré. Elle éclipse le soleil dont les rayons l’entourent comme s’ils jaillissaient de son propre corps, les uns grands et droits comme des épées ; les autres en forme de flamme. Elle est soutenue par un ange cariatide que l’on voit jusqu’à la ceinture, porté par des ailes d’aigle à demi déployées, et dont les pieds semblent se perdre dans la nuée qui nimbe toute la vision.
Si telle fut la description du voyant, l’évêque dut bien reconnaître l’ « Inmaculada » dont la dévotion était en particulier honneur dans l’ordre franciscain. Mais l’Indien ajouta sans doute qu’elle était enceinte, à cause d’un détail, qui pour lui devait être indubitable, et cela dut achever d’ébranler le premier évêque du Mexique.
L’ÉVÊQUE DEMANDE UN SIGNE
Il lui fallait autre chose que des paroles. Il réclama un signe. Juan Diego promit de le demander à la Reine du Ciel. L’évêque congédia le voyant, mais il donna l’ordre à quelques gens de sa maison de le suivre. Parvenus aux abords du pont du Tepeyac, dans le ravin, ils ne le virent plus. Disparu ! Après avoir battu en vain tous les sentiers et les buissons, ils revinrent, déconfits et furieux, raconter à l’évêque comment ils avaient été semés par cet imposteur.
Pendant ce temps, Juan Diego avait retrouvé sa muchachitaet lui dit la réponse de l’évêque. « C’est bien, mon fils, répondit-elle. Tu iras demain porter à l’évêque le signe qu’il te demande, afin qu’il te croie. Sache que je récompenserai ton souci, ta peine et ta fatigue. Maintenant va-t’en ; je t’attends demain. »
Mais le lendemain lundi, Juan Diego n’était pas au rendez-vous. De retour à la maison, il avait trouvé son oncle Juan Bernardino très malade. Et le soir l’oncle pria son neveu d’aller à Tlatelolco chercher un prêtre.
« VA CUEILLIR DES ROSES »
Ce mardi 12 décembre donc, alors qu’il faisait encore nuit, Juan Diego se mit en route. Parvenu près de la colline du Tepeyac au pied de laquelle débouche le chemin qui mène à l’endroit où le soleil se lève, là même où il avait l’habitude de passer, il se dit : « Si je prends ce sentier, la Reine risque de me voir et de m’arrêter pour me donner le signe que demande l’évêque. Pourtant, il faut que je m’occupe de notre malheur, que j’aille trouver ce prêtre. Mon pauvre oncle est en train de souffrir et il attend cette visite. » Aussi chercha-t-il un chemin détourné pour ne pas la rencontrer « croyant dans sa naïveté, qu’en empruntant un autre sentier il ne serait pas vu par Celle qui nous regarde tous ! Il la vit, comme elle descendait du haut de la colline où elle lui était apparue la première fois. Elle venait à sa rencontre d’un côté de la montagne, lui coupant le passage et s’arrêtant en face de lui :
« Eh bien, mon petit enfant, où cours-tu donc ? où t’en vas-tu ? »
Mais lui, tout gêné, honteux et même effrayé, tomba à genoux :
« Ma Petite, ma toute Petite, ma Reine, que Dieu te garde ! Comment t’es-tu levée ce matin ? Ta bien-aimée petite personne se sent-elle bien ? Ma Dame, mon enfant, je vais attrister ton visage et ton cœur ; sais-tu qu’un de tes enfants se meurt ? Mon oncle est très malade, on ne peut guérir le mal qui l’emporte, il est à la mort et je me hâte d’aller dans une de tes demeures à Mexico pour chercher l’un des amants de Notre-Seigneur, un de nos chers prêtres pour confesser mon pauvre parent et faire tout ce qu’il faut. Certes, c’est pour cela que nous sommes nés, pour attendre que notre mort fasse son office.
« Mais si, pour l’instant, je dois m’acquitter de cette tâche, je te promets de revenir à un autre moment pour transmettre ton message. Ma Dame, ma petite jeune fille, pardonne-moi et pour l’heure sois patiente avec moi ; je ne veux pas te tromper, ma toute petite fille, mon enfant. Demain, sans faute, je reviendrai au plus vite. »
Lorsqu’elle eut écouté ce discours, la Vierge pleine de miséricorde répondit par des paroles que, depuis lors, tout pèlerin rapporte de sa visite au Tepeyac, comme le trésor unique de sa pauvre vie :
« Écoute-moi bien, mon petit, le plus petit, et mets bien ceci dans ton cœur : ce qui t’afflige, ce qui t’effraye n’est rien. Que ton visage ne se trouble aucunement, non plus que ton cœur. Ne crains pas cette maladie, ni aucune autre épreuve, n’aie nulle angoisse, nulle peine. Ne suis-je pas là moi qui suis ta mère ? N’es-tu pas sous mon ombre, sous ma protection ? N’est-ce pas moi qui suis ta santé ? N’es-tu pas au creux de mon manteau, dans mon giron ? Que te faut-il de plus ? Non, n’aie nulle angoisse, aucune amertume et que la maladie de ton oncle ne t’afflige pas, car pour l’instant il n’en mourra pas. Sois sûr qu’il est déjà guéri. »
Dès qu’il eut entendu ces paroles, Juan Diego fut tout consolé et son cœur s’apaisa. Il se mit alors à supplier la Reine du Ciel de l’envoyer sans tarder à l’évêque avec un signe, une preuve. Elle lui ordonna de monter au sommet de la colline à l’endroit où elle lui était apparue :
« Monte, mon fils, le plus petit, au sommet de la colline, et là où tu m’as vue et entendue, là tu verras des fleurs variées. Coupe-les, rassemble-les, fais-en un bouquet puis descends et apporte-le ici en ma présence. »
Alors, Juan Diego grimpa jusqu’au sommet, où l’on ne voit que des rochers, des chardons, des épines, des nopals, des acacias, et là il s’arrêta, cloué d’admiration : elles étaient bien là en parterre, épanouies ; des fleurs de toutes sortes, des fleurs délicates de Castille, couvertes d’une rosée qui leur faisait une parure de perles fines.
Il s’empressa de les couper puis en fit une gerbe qu’il plaça dans son tablier et se hâta de redescendre auprès de la Reine du Ciel. Celle-ci, après les avoir regardées, les prit dans sa petite main et les disposa au creux de l’ayatede Juan Diego en lui disant :
« Mon tout petit enfant, ces fleurs si variées sont le signe que tu apporteras à l’évêque. Tu lui diras de ma part qu’il doit réaliser mon désir et ma volonté, que tu es bien mon messager et que j’ai mis ma confiance en toi. Une fois en présence de l’évêque, tu ouvriras ton manteau, et tu lui montreras ce que tu lui apportes. Et tu lui raconteras tout, lui disant comment je t’ai ordonné de monter tout en haut de la colline pour couper ces fleurs et tout ce que tu as vu et admiré. Avec cela tu toucheras le cœur de ton évêque et il consentira à élever l’église que je lui ai demandée. »
LE PRODIGE INOUÏ
Après avoir entendu la recommandation de la Reine du Ciel, il allait gaiement, sûr du succès de sa mission. Il regardait sans cesse les fleurs qu’il portait dans son manteau et il jouissait de leur parfum. Parvenu chez monseigneur l’évêque, il tomba sur ses gardes et ses valets et les pria instamment de le prévenir qu’il désirait être reçu. Mais aucun d’entre eux ne lui prêta attention. Il était encore trop tôt ; et puis ils commençaient à le connaître. Il ne leur causait que du désagrément ; ils étaient excédés de ses visites. D’ailleurs, leurs compagnons leur avaient raconté comment il les avait égarés.
Il patienta ainsi longtemps. Le voyant pourtant qui attendait en vain d’être appelé, et surtout intrigués de savoir ce qu’il serrait dans son manteau, ils s’approchèrent de lui tout en le menaçant. Juan Diego, voyant qu’il lui était impossible de cacher plus longtemps son trésor, le leur montra un petit peu c’était des fleurs ! Quand les gardes virent la variété des fleurs qui venaient de Castille, toutes fraîches malgré la saison, épanouies et exhalant un délicieux parfum, fort étonnés et curieux, ils tentèrent par trois fois d’en saisir quelques-unes. En vain ; au moment de les prendre, ils ne voyaient plus les fleurs que peintes ou brodées, ou tissées sur le manteau. Alors, ils allèrent trouver l’évêque pour lui raconter ce qu’ils avaient vu, lui disant que le petit Indien qui était déjà venu plusieurs fois demandait à être reçu et qu’il attendait déjà depuis un bon moment. L’évêque pensa qu’il venait, peut-être, lui apporter la preuve qu’il avait demandée et donna immédiatement l’ordre de le faire entrer.
« C’EST UNE FEMME » (AP 12)
Juan Diego entra, se prosterna comme à l’accoutumée et dit :
« Monseigneur et mon maître, j’ai fait tout ce que tu m’as demandé. J’ai parlé à la Dame, Notre Dame, la Reine du Ciel, Sainte Marie, la Mère admirable de Dieu. Je lui ai dit que tu désirais un signe pour pouvoir me croire et accepter de lui construire une église là où elle le demande et je lui ai dit également que j’avais promis de te rapporter ce signe, comme preuve de sa volonté exprimée par moi. Ainsi, elle a bien voulu t’accorder ce signe afin que tu réalises sa demande. »

Au même instant, il ouvrit son manteau blanc qu’il tenait serre contre lui, les fleurs de Castille en tombèrent. Et c’est alors que l’Image vénérable de la parfaite et toujours Vierge Sainte Marie Mère de Dieu apparut soudain, peinte sur le manteau. Elle apparut en entier telle qu’on peut la voir à présent, empreinte sur le même ayate.
Quand l’évêque la vit, et avec lui ceux qui l’entouraient, tous s’agenouillèrent et demeurèrent muets d’admiration, infiniment émus et le cœur débordant d’amour. L’évêque en larmes lui fit sa prière, la suppliant de lui pardonner de n’avoir pas immédiatement réalisé sa volonté. Puis il se releva, détacha l’Image de la Reine du Ciel du cou de Juan Diego et l’emporta pour la placer dans son oratoire. Juan Diego demeura toute la journée chez l’évêque jusqu’au lendemain. Alors, celui-ci lui dit :
« Allons, en route ! Tu vas nous montrer où la Reine du Ciel veut que l’on construise cette église. »
Quand Juan Diego eut montré l’endroit où la Reine du Ciel avait ordonné qu’on lui construise son teocaltzin, il dit aux gens qu’il voulait aller voir chez lui son oncle Juan Bernardino qui était à l’agonie lorsqu’il l’avait quitté pour chercher un prêtre afin de le confesser et le préparer à mourir, et que la Reine du Ciel avait guéri.
ELLE A DIT SON NOM
Quelques personnes l’accompagnèrent donc ; et quand ils furent chez lui, ils trouvèrent l’oncle sur pied, sans plus de douleur. Il était fort étonné de voir ainsi son neveu en si honorable compagnie. Juan Diego lui raconta comment, alors qu’il partait chercher un prêtre, la Reine du Ciel lui était apparue sur le Tepeyac et lui avait ordonné d’aller trouver l’évêque et de lui dire sa volonté d’édifier une église à cette place. Elle lui avait dit de ne pas s’en inquiéter car son oncle était guéri.
L’oncle dit que c’était la vérité, qu’elle l’avait bien guéri et qu’il l’avait vue telle qu’elle s’était montrée à son neveu et qu’elle lui avait même ordonné d’aller voir l’évêque. Elle l’avait guéri miraculeusement à l’instant même où elle lui était apparue et elle lui avait dit encore qu’il fallait appeler sa précieuse Image la « toujours Vierge Marie de Guadalupe ».
Plus tard, on conduisit Juan Bernardino à l’évêque pour qu’il témoigne en sa présence. Il les hébergea tous deux chez lui quelques jours pendant que l’on construisait la chapelle de la Reine du Ciel sur le Tepeyac, là où elle était apparue à Juan Diego.
L’évêque transféra ensuite la Précieuse Image de la Reine du Ciel dans la Iglesia Mayor, l’église des franciscains qui servait alors de cathédrale. Il la sortit de l’oratoire de sa maison pour que tous la voient et l’admirent, cette ravissante Image. Alors toute la ville se mit en mouvement ; tous venaient la voir, l’admirer, la vénérer comme chose divine et la prier, s’étonnant de la merveille par laquelle elle s’était manifestée. En effet, ce n’est pas un homme de cette terre qui a peint la ravissante Image.
PREMIERS MIRACLES DE LA SAINTE IMAGE
Un second récit indigène, sensiblement postérieur au premier, raconte le transfert de l’Image sainte de la cathédrale en son teocaltzindu Tepeyac : l’ « ermitage Zumárraga », où elle résidera jusqu’en 1556 et dont des fouilles ont remis au jour les fondations.
« Quand pour la première fois ils la conduisirent au Tepeyacac, dès que son temple fut achevé, eut lieu le premier de tous les miracles qu’elle a faits.
« Il y eut alors une grande procession où l’accompagnèrent tous les ecclésiastiques sans exception et quelques Espagnols parmi les autorités de la ville, ainsi que tous les seigneurs et nobles Mexicains et d’autres gens venus de partout. Tout fut disposé et décore avec magnificence sur la route qui va de Mexico au Tepeyacac, où avait été édifié le temple de la Dame du Ciel. Tous étaient en grande liesse. La route était bondée et sur la lagune, des deux côtés, où l’eau était encore très profonde, glissaient des canoës remplis d’indigènes. Survint une vive querelle. L’un des archers, déguisé à la mode chichimèque, tendit un peu son arc et par inadvertance lâcha soudain la flèche qui atteignit l’un de ceux qui se disputaient, lui traversant le cou. Il s’écroula. Le voyant mort, ils l’emportèrent pour l’étendre devant la toujours Vierge notre Reine. Les siens l’invoquèrent pour qu’elle daignât le ressusciter. Dès qu’on lui eut ôté la flèche, non seulement elle le ressuscita, mais il guérit de sa blessure. On ne voyait plus que les marques laissées par la flèche à l’endroit où elle avait pénétré. Alors il se leva la Dame du Ciel le fit marcher tout rempli de joie. Tout le monde était saisi d’admiration et louait l’Immaculée Dame du Ciel, Sainte Marie de Guadalupe qui déjà tenait parole. Car elle avait promis à Juan Diego qu’elle secourrait toujours et défendrait ces indigènes et ceux qui l’invoqueraient. À ce qu’on dit, ce pauvre Indien est resté depuis lors dans la maison bénie de la sainte Dame du Ciel, adonné au balayage du sanctuaire, de son patioet de son entrée. »
Un vieux cantique indien, le Teponazcuicatl, ou chant de l’atabal, d’origine certainement païenne, mais habilement adapté au christianisme, a conservé le souvenir de cette cérémonie :
« Ton âme, ô Sainte Marie,
Paraissait vivante sur la peinture.
Nous, les seigneurs, chantions pour Elle
Derrière le Grand Livre,
Et nous dansions à la perfection,
Et toi, évêque, notre père, tu prêchais
Là-bas, au bord du lac. »
LE “ PETIT PUITS ” DE NOTRE-DAME
Nous ne pouvons pas reproduire ici ces annales de la première génération guadalupana. Elles s’achèvent sur la mort de Juan Diego, survenue la même année que celle de Juan de Zumárraga (1548), mais elles contiennent aussi le récit d’événements postérieurs à cette date. L’étude critique de chacun des épisodes oblige à conclure à leur historicité certaine. Attachons-nous à celui du Pocito.
L’évêque voulut un jour connaître le lieu précis de la quatrième apparition. Comme Juan Diego hésitait, une source jaillit miraculeusement qui désigna l’endroit où la Vierge lui avait barré la route au moment où il cherchait à lui échapper, et l’avait envoyé cueillir des fleurs au sommet de la colline.
« Peu après sa manifestation à Juan Diego et la tout à fait prodigieuse apparition de son Image, la Dame du Ciel a fait de nombreux miracles. À ce qu’on dit, c’est aussi à ce moment-là que s’est mise à couler la petite source qui se trouve derrière le Temple de la Dame du Ciel, vers l’orient (…) L’eau qui y jaillit, bien qu’elle abonde en bouillonnant, ne déborde pas pour autant. Le chemin qu’elle parcourt n’est pas long mais très court au contraire. Elle est très propre et odorante, mais pas agréable ; elle est légèrement acide et bienfaisante pour toutes les maladies de ceux qui la boivent volontiers et s’y baignent. C’est pourquoi, ils sont innombrables les miracles que par cette eau a opérés la toute pure Dame du Ciel, notre ravissante Mère Sainte Marie de Guadalupe. »
Plus tard, en 1582, l’Anglais Miles Philips passe par là et raconte : « Il y a ici des bains froids qui coulent à flots comme si l’eau bouillonnait, laquelle est très légèrement saumâtre au goût, mais très bonne pour laver ceux qui ont des blessures ou des plaies. À ce qu’on dit, elle en a guéri beaucoup. » (…)
En 1780, on construit une chapelle pour abriter cette source, sans l’autorisation prescrite pour une telle entreprise. Le vice-roi Martin de Mayorga demande des explications au chapitre de la collégiale. Les chapelains répondent (…).
« Depuis lors, on a fait à cette jolie source une enceinte, une sorte de margelle, pour contenir ses eaux. C’est de là que provient son nom, encore usité aujourd’hui, de Petit Puits de Notre-Dame. Bien qu’il ne soit pas fait mention de construction immédiate de chapelle en cet endroit, il en existait une cependant au début du siècle passé, comme le rapportent les historiens de cette époque, et ce site a toujours été l’un des lieux les plus vénérés et les plus fréquentés par toutes sortes de gens, spécialement par les gens de passage. En effet, la chapelle se trouve sur la grand-route de Veracruz et d’autres villes du royaume. Encore aujourd’hui, elle est vénérée par les Indiens et les gens du peuple qui, lors même qu’ils ne visitent pas l’église principale, ne manquent jamais d’aller à la chapelle du Petit Puits à cause de la foi qu’ils ont en ses eaux, bienfaisantes à toutes sortes de maladies. Ainsi l’affluence est immense à toute heure et en tout temps, et l’on ne peut évaluer la quantité d’eau qui s’y puise. C’est la raison pour laquelle on a toujours eu soin de tenir ce lieu dans la décence qui convient et il a fallu souvent réparer la chapelle. En effet il y a grande difficulté à maintenir debout les édifices de cette région où abondent les exhalaisons nitreuses et sulfureuses… »
Cent ans plus tard, un Français, parfait rationaliste, Eugène Boban, note :« Nous ne parlerons pas de la fête en l’honneur de Notre-Dame de Guadalupe ; elle a été décrite dans toutes les langues et perd de plus en plus de son cachet original. Aujourd’hui les indigènes se contentent généralement de manger du chito (agneau rôti) et de s’enivrer avec le pulque, le tlachique (boissons fermentées extraites de l’agave mexicana) et le chiguinito (eau-de-vie de cannes) (…). Toutefois, nous signalerons, parmi les choses curieuses à visiter, la fameuse source alcaline, le Pocito, dont l’eau, couleur de rouille, est toujours bouillonnante.
« Cette source se trouve au milieu d’une petite chapelle de style mauresque très intéressant ; là se presse une foule munie de vases de toutes formes, et de bouteilles, afin de puiser l’eau de la source qui, miraculeuse, ainsi que l’eau de Lourdes, passe pour guérir toutes les maladies. »(Eugène Boban, Catalogue raisonné de la collection de M. E. Goupil, Paris 1891, t. II p.199).
Par contre, pour avoir visité le Pocito, je n’ai rien à changer à la description qu’en a faite Boban. La même animation règne à l’entrée de la chapelle où se trouve le Puits dont l’eau est distribuée par les souriantes religieuses du sanctuaire, car les pèlerins n’y ont pas accès directement. Malgré l’assèchement de la lagune, accentué par les travaux de construction du métro, elle continue à sourdre, mystérieusement, mais plus profond, et abreuve ceux qui la boivent avec foi.
J’en ai rapporté et j’en ai donné à boire peu après mon retour à un jeune homme dont l’état était désespéré. Il est aujourd’hui en parfaite santé… sans aucune autre intervention. Ceux de son entourage qui ne savent pas cela, disent son rétablissement inexplicable.
Je ne crie pas au miracle, mais je l’atteste comme je l’ai vu et le vois, pour montrer, comme dit le Père Beltran, « la filiale confiance » que l’on peut mettre en la « poderosa protección » de Sainte Marie de Guadalupe.
La suite de l'article de Frère Bruno Bonnet-Eymard se trouve aux liens suivants :
- Mythe ou réalité ?
- « La révélation de la beauté »
- L’énigme d’une image prodigieuse
- La vierge qui a façonné une patrie
A découvrir aussi
- La conception immaculée de Marie
- Je suis l'Immaculée Conception
- L’Esprit Saint, La Trinité et L’Immaculée Conception
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 350 autres membres